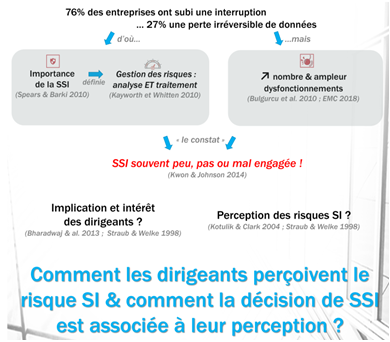Chacun de nous, utilisateur, manager en entreprise ou spécialiste de la sécurité, a des besoins et une compréhension différente et parcellaire du problème.
Les différentes parties prenantes dans une organisation expriment des attentes différentes. Les différents acteurs dans le large champ de la sécurité de l’information ne partagent pas une même vision.
Chacun exprime des besoins qui ne sont pas complètement satisfaits.
Les dirigeants comprennent que des obligations légales, réglementaires et de performance s’imposent à leur organisation. Ils s’appuient alors sur leurs collaborateurs directs pour que : informaticiens, juristes, responsables sécurité, leur apportent les dispositifs adaptés à leurs attentes.
Les dirigeants ont une perception directe de leur responsabilité vis-à-vis des exigences de conformité et de performance qui s’imposent à leur organisation.
Les réponses de leurs collaborateurs directs ne sont pas toujours de nature à les assurer de l’efficacité des moyens engagés. Ils expriment alors leur doute sur les dispositifs mis en place.
Les directeurs des systèmes d’information ont une compréhension opérationnelle de leurs responsabilités en matière de services à rendre aux directions métier et à l’obligation de performance liée à leurs objectifs et à leurs SLA. Ils expriment leurs attentes vis-à-vis de leurs chefs de services et du pôle de sécurité (lorsqu’il est dans le périmètre de leur responsabilité) pour qu’ils définissent des plans d’actions de nature à satisfaire la demande de la DG relative à la conformité et à la performance voulues.
Les plans d’action définis n’ont pas toujours la cohérence attendue par les directeurs des systèmes d’information et ne sont pas toujours mis complètement en œuvre. Le manque d’articulation avec les métiers, l’insuffisance de ressources humaines, ne facilitent pas l’adéquation de la réponse à la demande.
Ils expriment parfois leurs attentes insatisfaites du niveau d’engagement budgétaire vis-à-vis de leur DG qui associe naturellement optimisation financière et performance. Les directeurs des systèmes d’information relaient les contraintes budgétaires qui leur sont imposées et arbitrent parmi les projets ceux qui contribuent au développement et à la productivité de l’organisation, plutôt que ceux qui protégeraient de risques hypothétiques.
Les Responsables de la sécurité des systèmes d’information ont une vision attentive des menaces et des vulnérabilités qui exposent les infrastructures informatiques, les données et les processus. Ils sont conscients de leur responsabilité sur l’efficacité des dispositions de protection fonctionnelles et techniques mises en œuvre et sur la gestion des incidents qu’ils opèrent. Ils sont généralement très compétents dans leur domaine technique et appréhendent bien les méthodologies d’analyse de risque des systèmes d’information.
Ils ressentent avec frustration l’insuffisance des moyens qui leur sont attribués pour combler toutes les failles qu’ils identifient.
Les pôles de sécurité sont centrés sur leur domaine de compétence et ne veulent pas se substituer aux directions métier de l’organisation pour définir leurs besoins en matière de sécurité de l’information.
Les directions métier ne sont que peu sollicitées dans leur contexte d’activité pour s’approprier leurs rôles d’acteurs dans le processus de gestion des risques. Ils maitrisent peu les critères de la sécurité pour exprimer directement leurs besoins. Elles considèrent que la sécurité est le domaine d’expertise des « informaticiens » et qu’ils n’ont que peu d’influence sur des systèmes à forte composantes technologiques.
Les différents acteurs de l’organisation se positionnent dans le champ de la sécurité avec une posture qui relève de leur culture professionnelle acquise par la pratique de leur métier ou de leurs responsabilités dans leur métier. Leur posture d’expert dans leur métier y compris celui de la sécurité, les enferment dans leur domaine et leur fait refuser d’émettre des avis et d’opérer des choix à la place de leurs homologues experts dans leurs domaines.
Les différents aspects de la sécurité de l’information sont ainsi parcellisés et vue comme à travers un Kaléidoscope sans que personne ne soit en position de dresser une vue globale de la problématique relative à la sécurité de l’information et de permettre de reconstituer le puzzle.
Il manque une vision commune et un langage commun, partagé.
Ainsi, pour se faire entendre dans le champ de l’entreprise, il faudrait être trilingue :
- Parler « business, valeur ajoutée et maitrise des risques »,
- Parler « qualité de services opérationnels »,
- Parler « menace, vulnérabilités et technologies ».
Dans cette grande discussion, quelle est notre langue maternelle ? Quelle est la langue de notre interlocuteur ? Est-on polyglotte ?
Dans cette « tour de Babel », s’il fallait un coupable, serait-ce le directeur des systèmes d’information, plus occupé à adapter les rapports selon ses positions qu’à jouer son rôle de traducteur et d’intermédiaire entre DG et opérationnels ? les métiers qui ne savent pas exprimer leurs besoins ? les informaticiens qui pratiquent un langage exclusif ?
Constituer un canal de communication entre les parties prenantes du système de management pour établir un vecteur de gouvernance entre stratégie et sécurité de l’information passe par une communication structurée dans le cadre d’une méthodologie.